Les romans américains
Les douze tribus d’Hattie***, Ayana Mathis (éd Gallmeister, 311 p)
Très beau premier roman, simple et puissant.
Après avoir fui le racisme de la Georgie en 1920, Hattie deviendra mère de douze enfants. Sa vie, semblable à celles de beaucoup d’autres femmes de cette époque, mères italiennes ou irlandaises, est dévoilée en filigrane au travers d’un moment particulier de la vie de ses enfants. On reconstruit ainsi à la fois la personnalité complexe d’Hattie comme les répercussions de l’éducation qu’elle leur a donnée ; ses sacrifices, ses combats, les failles créées par l’absence de tendresse de cette mère qui devait chaque jour trouver de quoi les nourrir et les vêtir.
Beaucoup de lecteurs pourront retrouver dans ce récit lumineux une part de leur histoire familiale du XXème siècle.
Le diable, tout le temps**, Donald Ray Pollock (livre de poche, 403 p)
Sombre, très sombre.
Un vrai roman noir américain, emplis de personnages perdus et monstrueux.
Tout serait bon à jeter : les personnages, l’histoire, le livre si tous ces protagonistes ne possédaient leurs propres failles. Ces liens qui les rattachent à d’autres, leurs obsessions, leurs dévouements, éclairent ces destinées humaines misérables et nous les rendent attachants, presque sympathiques.
Très loin des histoires de tueurs en série, ce récit nous projette sur des gens ordinaires qui ont basculés et chutés, sans espoir de rédemption. Non, le diable n’est pas présent tout le temps dans cet ouvrage qui parle finalement aussi beaucoup d’amour, il semble surtout partout, tapi en chacun de nous.
Un grand livre que l'on referme avec un certain soulagement.
La musique du hasard**, Paul Auster (Livre de poche 224 p)
Paul Auster n’aurait pu trouver meilleur titre pour introduire l’histoire de cet homme qui n’a aucun sens à donner à sa vie. Riche de 200 000 dollars, il parcourt l’immensité américaine jusqu’à ce qu’une rencontre imprévue l’entraine vers une autre voie, aussi absurde que la précédente.
Et pourtant ce roman possède une surprenante force d’attraction.
Qualité de l’écriture, fascination pour ces personnages qui glissent doucement vers leur anéantissement ? Cet univers décalé et absurde, intriguant, inquiétant, capte l’attention.
Ce deuxième Paul Auster m’a fait comprendre beaucoup mieux que ne l'avait fait La nuit de l’oracle l’intérêt que les lecteurs portent à cet auteur.
La maison du bout du monde ****– Michael Cunningham (domaine étranger 10/18, 425 p)
Un livre au charme très insidieux.
On croit au premier abord avoir affaire à une histoire vaguement caricaturale des années 80 (ce que laisse d’ailleurs penser la 4ème de couverture). Puis on découvre tout un éventail de relations humaines et des personnages d’une grande justesse.
L’analyse de leurs caractères, leurs questionnements sur leurs devenirs, sur le sens qu’ils veulent donner à leurs vies (ou parfois sur l’absence de sens), tout «l’habillage » du roman crée une résonnance qui lui permet de dépasser le champ de cette histoire particulière pour s’adresser à tous.
De plus l’écriture très agréable de Cunningham est accessible cette fois-ci, au contraire de son roman « Les heures », dont les subtilités ne pouvaient être saisies que par les connaisseurs de l’œuvre de Virginia Woolf.
Une réussite inattendue et un vrai coup de cœur pour cette œuvre que je relirais volontiers.
« - De tous les êtres sur terre, c’était vraiment lui que tu voulais épouser ? Tu n’as jamais craint de faire une sorte d’erreur à terme, de perdre le fil de ta vraie vie et de partir, je ne sais pas, sur une tangente sans retour ? »
Elle écarta la question d’un geste de la main comme si elle chassait une mouche à moitié endormie mais obstinée. Ses doigts étaient rouge tomate. « Nous ne nous posions pas de questions aussi importantes, dit-elle. N’es-tu pas fatigué de tant penser, t’interroger, planifier ? »
Voleurs *** Christopher Cook (éd Payots Rivages/noir, 548 p)
Les 470 premières pages de ce road-movie bien construit se tirent une balle en trois malheureuses petites pages, un vrai suicide collectif ! Imaginez, dans la scène finale de « No Country for old men », que les frères Coen fasse raconter au tueur sa petite enfance, et que sa future victime se mette subitement à faire le ménage. Vous auriez alors une idée précise de ma stupéfaction.
Malgré cet accroc, je n’ai aucun doute sur le fait que nous entendrons à nouveau parler de cet auteur qui se place dès son premier livre dans la cour des grands. Précision des scènes, épaisseur des personnages, ambiance moite et étouffante des marais cajuns, nous voici placés un bon cran au-dessus d’ Ellory, et de mon point de vue, c’est plutôt une bonne nouvelle.
Auteur à suivre.
Dérive sanglante***, William g. Tapply ( éd. Gallmeister, 298 p)
La désolante traduction du titre original (Bitch creek) ne rend pas hommage à ce polar naturaliste qui sort très agréablement des sentiers battus.
Bien loin des policiers sanglants souvent ancrés dans le sud des Etats-Unis, cette intrigue s’enracine dans les paysages magnifiques du Maine, dans une petite bourgade isolée où tous les habitants se connaissent et s’observent sans même le vouloir.
Après avoir été frappé par la foudre, Stoney Calhoun y a reconstruit sa vie avec une mémoire quasi-vide, des flashs énigmatiques, une intolérance à l’alcool et un goût prononcé pour la pêche à la mouche. Qui était-il ? Le bouleversement inattendu de son quotidien va l’obliger à se confronter à son ancienne personnalité.
Le charme de ce personnage et de son chien font toute la saveur de cette quête originale, seule la fin souffre d’un léger manque d’approfondissement. Une belle surprise.
Les saisons de la nuit***, Colum Mc Cann (Coll 10/18, 320 p)
Des « gadouilleux » qui ont construit les souterrains du métro aux bâtisseurs de gratte-ciel, l’histoire de cette famille d’ouvriers afro-américains reprise sur trois générations livre tout un pan de l’histoire de new-York. Les méandres de la ville, ses souterrains, ses exclus ; la forte ségrégation raciale, la vie difficile des couples mixtes.
Toute la force de la littérature américaine condensée en 300 pages : pur, dur, bien écrit.
Un roman social ; un beau roman tout simplement.
Mississippi****, Hillary Jordan (éd. 10/18, 361 p)
Cette magnifique chronique familiale portée par six voix d’hommes et de femmes, de blancs et de noirs, est une symphonie maîtrisée de bout en bout. Mississipi des années 40, retour des héros de guerre. Pourront-ils réintégrer cette terre âpre et boueuse, elle, qui possède et absorbe les hommes aussi sûrement que la mer ?
Des personnages denses et crédibles, un style fluide, un récit puissant, que dire d’autre ? L’équilibre de l'histoire aurait frisé la perfection si le grand-père avait eu une petite voix au chapitre.
A découvrir.
La chorale des maîtres bouchers***, Louise Erdrich (Livre de poche 568 p)
Cette très belle écriture happe immédiatement et fait traverser sans à-coups toute la période d’entre-deux guerres dans une petite ville des grandes plaines américaines. Sans être lisse, cet entremêlement de vies souffre pourtant d’un léger manque de rythme, peine à éveiller pleinement nos émotions. On finit par se demander où tout cela nous emmène.
Ce livre rentre pour moi dans même catégorie que « Le déclin de l’Empire Whiting » : force d’évocation, belle écriture, densité des personnages. Pour l’un comme pour l’autre, malheureusement, l’absence d’implication du narrateur dans sa propre vie freine l’empathie du lecteur.
Réservé aux bons lecteurs et aux amateurs d’ambiances américaines. (Une étoile de plus que prévu pour l'indéniable qualité de style).
Féroces* Robert Goolrick (Pocket, 247p)
Le choix de dévoiler dans la dernière partie l’événement qui a fait basculer sa vie amène l’auteur à construire l’ensemble de l’histoire sur un non-dit.
Dans ses souffrances d’adulte, dans la relation ambigüe entretenue avec ses parents, on devine que sa hargne et sa tristesse ont une vraie cause. En attendant, je me suis ennuyée dans ces petites scénettes sensées expliquer son malaise puisqu’il ne décrit au final qu’une famille ordinaire de la middle class américaine des années 50. Mère au foyer qui s’ennuie, père enseignant, cocktails, robes de soirée, alcool un peu trop présent, fort souci des apparences. Les psychodrames, tels l’absence de vélo ou la robe trouée de sa mère sont tombées à plat, mettant surtout en lumière l’immaturité du narrateur.
Bien sûr, la révélation éveille une compassion sincère, mais comment ne pas s’interroger sur tout ce fartas, sur les incohérences du récit accentuées par des oublis ? Peux-t-on faire porter à cet événement la responsabilité complète du ratage de sa vie d’adulte, après un tiers de livre passé à décrire une enfance plutôt heureuse ? Sa mère, alcoolisée, a-t-elle véritablement compris la scène avec l’obscurité ? Pourquoi n’a-t-il jamais réussi à avoir une conversation une fois adulte avec elle ?
Trop de questions sans réponse et une construction de récit inappropriée gâche de mon point de vue le propos de ce livre, qui a pourtant le mérite de parler d’un sujet difficile et insuffisamment abordé.
Dans le silence du vent*, Louise Erdrich (Albin Michel, 462p)
Si ce livre apporte un éclairage intéressant sur la vie indienne et les carences de la justice dans les réserves américaines, il souffre d’un cruel manque de rythme. Les descriptions sans intérêt abondent, tous les repas pris par le héros sont détaillés inutilement (son oncle lui met 3 feuilles de laitue Iceberg dans son sandwich…) et, plus gênant, l’élégance de style qui faisait le charme de « La Chorale des Maîtres bouchers » a disparu, au point qu’on pourrait le croire écrit par un autre auteur.
Il est regrettable que la forme ne suive pas plus le fond dans ce plaidoyer pour une meilleure justice pour les femmes indiennes, dont plus d’un tiers est violé par des non-indiens, et ce, le plus souvent sans possibilité de recours légal du fait de l’imbroglio des lois les concernant.
Une déception à la hauteur de mes attentes concernant cet auteur !
Courir avec des ciseaux*** Augusten Burroughs (éditions 10/18, 317 p)
Augusten Burroughs nous narre avec humour son adolescence passée au milieu d’adultes sans repères. On rit d’un œil, on pleure de l’autre, on est bringuebalé d’un bout à l’autre jusqu’à la fin du récit. Impressionnant de lucidité et de détachement, très cru parfois, il nous livre une histoire qui serait effroyable sans cet humour omniprésent. Voici la preuve que la folie n’est pas contagieuse. Respect !
Extrait : Nous possédions un trésor : la liberté. Personne ne nous disait qu’il était l’heure d’aller au lit. Personne ne nous disait d’aller faire nos devoirs. Personne ne nous disait que nous ne pouvions pas boire deux packs de Budweiser pour aller ensuite vomir dans la machine à laver. Alors, pourquoi nous sentions-nous à ce point prisonnier ?
Le château de verre*** Jeannette Walls (Pocket, 442 p)
Touchante autobiographie d’une journaliste New-Yorkaise dont l'enfance s'est déroulée avec des parents aussi aimants qu'inconscients. De son enfance bohème, dépourvue d'argent et riche d'expériences, elle sort grandie grâce à une force de caractère admirable.
Très joli livre et vraie leçon de vie. J’aurai plaisir à le prêter pour le faire découvrir.
Le déclin de l’empire Whiting**, Richard Russo (éd. 10/18, 633 p)
Un rythme lent adapté au déclin de cette petite ville américaine nostalgique de son passé, des personnages communs et pourtant attachants, une trame d’histoire intéressante. Malheureusement la lenteur de la mise en place de l’intrigue m’a freiné (le rythme s’accélère sur la fin) et les nombreuses redites lors de la présentation du caractère des personnages n’ont fait qu’accentuer ce sentiment d’étirement. Autant certains passages, ceux concernant Tick ou sa mère par exemple, sont émouvants de par leur finesse, autant j’ai trouvé agaçant de relire quatre fois que Silver Fox joue au rami en maillot de corps, que David a perdu son bras (il le redit à chaque conversation), ou bien que le nom de Max soit toujours évoqué en précisant qu’il vit aux crochets de tous (j’ai perdu le compte).
Dans ce style d’histoire, petite ville touchée par un drame mêlée à l’étude psychologique de gens ordinaires, j’ai préféré « De si beaux lendemains » de Russell Banks.
Extrait : Janine n’identifiait que trois besoins primitifs : manger, baiser, et assassiner cette emmerdeuse de mère. Elle n’aurait pas su préciser lequel était le plus puissant, mais ne doutait pas que le troisième fut le plus dangereux, peu de choses semblant en mesure de s’y opposer. « Tu sais quoi, Béatrice ? »demanda Janine, qui n’employait le prénom entier que pour suggérer la proximité d’un nouveau matricide. « Tu es jalouse, voilà. » De sa jeunesse relative, de son activité sexuelle et du poids perdu, cela allait sans dire.
Aztèques Dansants**, Donald Westlake (Payot / Rivages noirs, 484 p)
Précisons tout de suite aux amateurs de Policiers que l’histoire ne présente aucun rapport avec l’univers traditionnel du polar : ni crime, ni enquêteur, ni ambiance noire.
Westlake a créé CINQUANTE personnages dans cette l’histoire (les noms sont fort heureusement repris dans une liste située en début d’ouvrage) et il a réussi l’exploit de donner une personnalité à chacun d’entre eux.
On peut regretter que toute cette énergie créatrice n’ait pas été mieux exploitée. La course poursuite après les Aztèques Dansants est endiablée et amusante, les deux principaux personnages attachants, seulement tout cela pour quoi ? La conclusion à un air de pétard mouillé.
Dans ce style décalé et loufoque, ma préférence va plutôt au Lézard lubrique de Mélancoly Love de Christopher Moo
Le chant de Dolores**, Wally Lamb (livre de poche, 706 p)
Dolores connait au début de son adolescence deux trahisons majeures, et il lui faudra presque une vie pour se reconstruire complètement.
Sa culpabilité, son désir d’autodestruction, sa lente reconstruction, son volonté farouche de redresser la tête, tout est parfaitement bien rendu. Ceux que la vie n’a pas ménagés y croiseront des étapes qu’ils ont eux-mêmes traversées sous une forme ou une autre. Voici certainement pourquoi, malgré son style agréable, ce livre n’a pas soulevé chez moi un enthousiasme débordant.
Le seigneur des porcheries***, Tristan Elgof (Folio, 607 p)
Passé le premier chapitre un peu difficile d’entrée, on plonge dans une fresque épique, fiévreuse, haineuse de l’Amérique profonde. Immersion totale dans un bled du Middle-west, cloaque humain auquel le personnage principal va faire payer sa vie ravagée par le mensonge, la bêtise et la cupidité de ses concitoyens. Cette écriture possède un vrai style même si elle souffre parfois de longueurs. Et il est impossible de rester indifférent au récit de la vie de cet enfant puis de cet homme hors du commun, cherchant à rester debout malgré ses différences et le sort qui s’acharne.
Dense, acide, brûlant. Unique !
Extrait : L’ombre immense d’une silhouette patriarcale planait sur lui depuis sa naissance et dans son demi-jour il ne pouvait s’empêcher de sentir qu’il avait d’ores et déjà été jugé impropre, qu’en empruntant pas immédiatement la voie tracée par son père, en n’étant tout simplement pas la copie conforme de Ford Kaltenbrunner, il décevait tout le monde.
La bête contre les murs****, Edward bunker (Rivages/noir, 297 p)
Edward Bunker, le plus jeune taulard à avoir intégré Saint Quentin (pénitencier connu pour être le plus dur des Etats-Unis), plusieurs fois récidiviste, nous parle de cette « tendresse essentielle » qu’évoque Romain Gary, cette tendresse qui nous permet de rester humains. Dans son style direct, avec une lucidité et une humanité stupéfiante, il nous montre l’intérieur de cette machine à broyer les hommes, cette violence impitoyable capable de transformer les petits délinquants en meurtriers sans scrupules en moins d’un an.
Réalisme, choix du thème, qualité de style, tout concorde dans cette œuvre puissante, âpre, fascinante. Très grand coup de cœur ! Chapeau bas pour cet homme qui a su conserver la part essentielle de son être dans un univers aussi hostile.
Aucune bête aussi féroce*, Edward Bunker (Payot Rivages Noir 443 p)
Un texte qui sonne juste, une qualité d’écriture remarquable au regard du parcours de l’auteur (foyers, maisons de redressement, prisons) dans un style dépouillé et direct, une véritable réflexion sur les causes de la criminalité et sur les difficultés d’éviter la récidive. Les anciennes connaissances, la non-confiance en soi qui incite à reprendre les chemins connus même s’ils mènent à des impasses, l’absence d’aide à la sortie pour les anciens détenus. L’auteur nous dévoile toutes ces vérités qui dérangent et qui sont toujours d’actualité. Voici pour les qualités.
Côté défauts on regrettera la personnalité du héros, brouillon, volontiers geignard et d’une mauvaise foi fatigante. Il est difficile de s’y attacher. Il se plante sur des broutilles (l’oubli des allumettes par exemple), ne suit aucun des conseils qu’il donne (rester discret sur ses futurs coups), se trouve facilement des excuses. Il se veut « homme d’honneur » et aide les femmes de ses amis taulards, mais peut les plonger sans remords dans les ennuis sous prétexte que « les temps durs font les gens durs ». Facile.
Je l’ai quitté sans regrets, ce qui explique un avis final très mitigé sur ce livre. Je tenterai cependant "La bête contre les murs" du même auteur dont j’apprécie beaucoup l’adaptation cinématographique sous le titre "Animal Factory" avec Edward Furlong et Willem Dafoe.
Beignets de tomates vertes*, Fannie Flag. (Pocket)
Chronique vivante et colorée de l'Alabama, le récit est porté par deux narratrices : une femme dépressive traversant la crise de la cinquantaine dans les années 80, et une vieille dame pleine de vie qui égrenne ses souvenirs des années 30 et en particulier ceux du café " le Wistle Stop". Les personnages très attachants et l'énergie qui se dégage de l'époque de la Grande Crise sont les grands atouts de cette histoire. Les protagonistes empoignent la vie à pleines mains sans se poser de questions et le contraste entre les deux époques est bien rendu. Le racisme et la ségrégation, omniprésents, sont traités avec finesse également.
Malgré toutes ses qualités, je dois reconnaître que je suis passée un peu à côté de ce livre visiblement très apprécié. L'aller-retour permanent entre les deux époques a été un frein à mon entrée dans le récit et malgré l'intérêt des histoires je suis restée spectatrice sans jamais réussir à y croire vraiment. J'ai largement préféré "La couleur des sentiments" de Kathryn Stockett situé dans le sud des Etats-Unis dans les années 50.
Le xxème siècle américain***, Howard Zinn (Agone, 444 p)
Dès la préface l’auteur pose un parti pris, ce qui pourra rebuter certains lecteurs mais cela semble fait pour cela.
Howard Zinn aborde l’histoire sous l’angle des relations sociales. Il ne voit pas les Etats-Unis en tant que Pays avec un grand P : entité unifiée et cohérente et qui n’a donc qu’une seule histoire : l’histoire officielle. Mais comme un ensemble de grandes forces sociales, groupes, minorités, classes moyennes ou populaires qui défendent chacun leurs intérêts et dont les désirs et les buts sont parfois très éloignés des décisions prises au plus haut niveau de l’état. Dans cette histoire, il y a des gagnants et des perdants, parfois durement réprimés. L’histoire extérieure du pays, longuement abordée, n’est plus que la résultante du conflit de ces forces intérieures. On trouve des grandes leçons de cynisme et des modèles de courage exemplaires dans ce livre. Cette vision à l’avantage de donner une grande cohérence à l’ensemble, les faits et dates ne sortent plus de nulle part, mais restant dans la logique des rapports de force dominants. Peut-être est-ce ce que l’on nomme le sens de l’histoire ?
Un livre très intéressant, même s’il ne faut pas prendre ce livre engagé comme unique point de vue. Cet aspect engagé, qui nuit à l’objectivité de l’ouvrage, sera un vrai frein pour les férus d’histoire.
Extrait de la préface : Une histoire qui se veut créative et souhaite envisager un futur possible sans pour autant trahir le passé devrait, selon moi, ouvrir de nouvelles possibilités en exhumant ces épisodes du passé laissé dans l’ombre et au cours desquels, même si ce fut trop brièvement, les individus ont su faire la preuve de leur capacité à résister, à s’unir et parfois même à l’emporter. Je suppose –ou j’espère – que notre avenir sera plus à l’image de ces brefs moments de solidarité qu’à celle des guerres interminables.
Contes de la Folie ordinaire*, Charles Bukoswski ( Livre de Poche)
Dépravé, alcoolique, bagarreur, prêt à baiser son meilleur ami s’il tombait par hasard dans son lit, Bukoswki est la version américaine trash de notre « Gros Dégeulasse » national (Reiser). La principale différence : Charles Bukoswski existe. L’auteur alterne de courts récits de fiction avec des épisodes autobiographiques dans lesquels il paraitrait presque sympathique à force de défauts. Affligeants, consternants, parfois franchement drôles, toujours édifiants, ces contes ne laissent pas insensible.
Une mention spéciale à la nouvelle dans laquelle l’héroïne transforme son conjoint en godemiché.
La vie aux aguets**, William Boyd Editeur : Seuil
Le principal intérêt de ce roman d’espionnage est d’évoquer une partie peu connue (par moi en tout cas) de l’histoire de la seconde guerre mondiale : la création par les services secrets britanniques d’un bureau de désinformation situé aux Etats-Unis. Bureau visant essentiellement à désinformer la population américaine pour la rendre favorable à une entrée en guerre en Europe. Le récit se construit grâce à deux récits croisés : celui de la mère, situé durant cette période, et celui de sa fille qui ignore tout du passé de sa mère. Les deux récits finissent par se rencontrer. Toutefois celui de la fille, peu mature et poussée par un vent calme, est largement moins intéressant, à mon avis. Si l’idée était de montrer que l’on ne connaît jamais complètement les gens qui nous entourent, elle est amenée assez lourdement.
Le livre au final est agréable à lire mais ne laisse pas d’impression marquante.
Extrait: « Et soudain elle ressentit le violent désir de tenir de nouveau un homme dans ses bras – le corps d’un homme nu contre le sien. Moins un acte sexuel que la possibilité de serrer, d’enlacer cette grande masse solide, cette étrange musculature, ces odeurs différentes, cette force différente. »







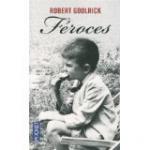







/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F25%2F08%2F1032731%2F117511377_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F14%2F66%2F1032731%2F117511185_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F76%2F29%2F1032731%2F117500530_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F96%2F1032731%2F116895987_o.jpg)